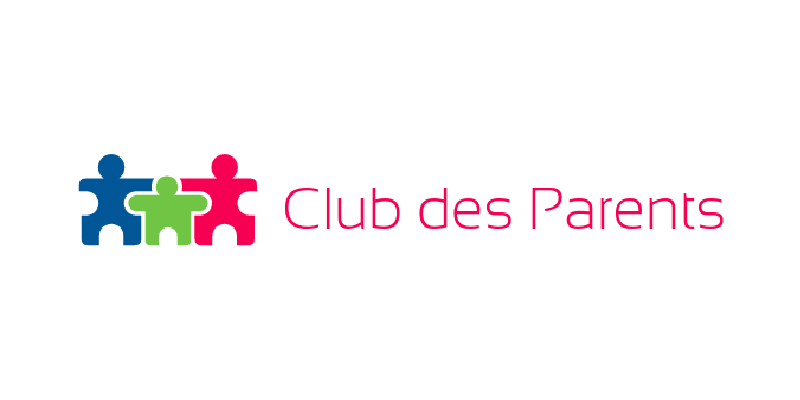Un enfant sur dix ne marche pas à 18 mois, sans que cela ne traduise forcément un trouble du développement. Certains bébés acquièrent la marche après 20 mois, alors même qu’ils présentent des compétences motrices globalement satisfaisantes.
Le seuil de « retard » varie selon les recommandations médicales et l’environnement familial. Toute inquiétude n’est pas nécessairement fondée, mais certains signaux méritent une attention particulière pour adapter l’accompagnement et solliciter un avis spécialisé si besoin.
Comprendre les grandes étapes du développement moteur chez l’enfant
Le développement moteur chez le jeune enfant avance sur deux chemins complémentaires : la motricité globale et la motricité fine. La première regroupe les mouvements amples, lever la tête, se retourner, s’asseoir, ramper, se mettre debout, marcher,, qui ouvrent la voie à l’autonomie. La seconde concerne les gestes plus précis : attraper une petite voiture, manipuler une cuillère, gribouiller une feuille. Chaque enfant trace sa route à sa façon, sans suivre une partition immuable.
Si le ramper apparaît souvent entre 7 et 10 mois, certains enfants préfèrent l’ignorer et se lancent directement dans la marche. Ce passage n’a rien d’obligatoire pour apprendre à marcher. La plupart des bébés font leurs premiers pas entre 12 et 18 mois, mais il n’est pas rare de voir un jeune aventurier marcher à 9 mois ou, au contraire, d’attendre jusqu’à 20 mois sans qu’aucune anomalie ne soit détectée.
Voici comment s’organise l’acquisition de ces habiletés :
- Motricité globale : elle se construit au fil d’activités comme rouler, ramper, marcher, grimper, courir, sauter.
- Motricité fine : elle progresse grâce au jeu, à la manipulation d’objets, à la construction, au dessin.
Ce parcours moteur s’appuie sur de multiples leviers : la morphologie, l’environnement, la personnalité, la stimulation quotidienne, le poids, la taille. Un espace riche en découvertes encourage la mobilité, mais la motivation propre à chaque bébé joue aussi un rôle déterminant : certains observent longuement avant de se lancer, d’autres foncent à la première occasion. Chaque histoire est unique, et seule une observation attentive permet de cerner les besoins réels de l’enfant.
Pourquoi certains bébés marchent-ils plus tard que d’autres ?
L’âge pour être un marcheur tardif ne s’explique ni par le hasard ni par une règle mathématique. Plusieurs facteurs s’entremêlent et dessinent le parcours moteur de chaque enfant. Le tempérament intervient en premier plan : certains préfèrent scruter longuement ce qui les entoure avant d’oser avancer, d’autres, plus audacieux, tentent l’aventure dès que leur équilibre le leur permet.
Le poids et la taille influencent également cette progression. Un bébé au gabarit plus généreux a parfois besoin de plus de temps pour maîtriser ses appuis. Il ne s’agit pas d’un signal inquiétant : le corps réclame simplement un délai supplémentaire pour trouver sa stabilité. La motricité libre fait aujourd’hui consensus : laisser l’enfant expérimenter, progresser à sa façon, sans pression ni accélération forcée, soutient l’apprentissage.
L’environnement occupe aussi une place de choix. Un espace trop encombré ou pauvre en stimulations limite les occasions de se mouvoir ; à l’inverse, un cadre sécurisé, varié et propice à l’exploration encourage la mobilité. Le rôle des parents consiste à accompagner, encourager, sécuriser, jamais à brûler les étapes.
Quelques points de repère permettent de mieux comprendre cette diversité :
- Certains enfants marchent plus tard sans que cela découle d’un trouble.
- Chaque trajectoire motrice traduit la singularité du développement de l’enfant.
Gardez toujours à l’esprit : l’acquisition de la marche se construit au fil de minuscules choix, d’essais, de découvertes et parfois d’hésitations.
Reconnaître les signes d’un retard de la marche : quand s’en préoccuper ?
Identifier un trouble de la marche exige nuance et attention. Si la majorité des enfants osent leurs premiers pas entre 12 et 18 mois, le fait de ne pas se déplacer du tout de façon autonome passé cet âge doit interpeller. Une vigilance accrue s’impose quand, à 18 mois révolus, l’enfant ne cherche pas à se lever ni à marcher en s’appuyant. Les chutes fréquentes, un déséquilibre persistant ou un manque d’intérêt pour l’exploration sont autant de signaux à considérer.
Certains signes associés doivent inciter à consulter :
- absence d’appui sur les jambes lorsqu’on soutient l’enfant sous les bras,
- muscles très raides ou, à l’inverse, une grande mollesse,
- utilisation asymétrique des membres,
- désintérêt pour la mobilité, alors que la motricité fine se développe normalement.
Dans ces cas, l’avis d’un professionnel de santé, pédiatre, kinésithérapeute, physiothérapeute, s’impose pour évaluer le développement moteur et proposer un bilan adapté. Il arrive que certaines difficultés soient liées à des troubles neurologiques, des atteintes de l’appareil locomoteur ou des problèmes vasculaires, parfois peu visibles lors des premiers examens. La peur de tomber, une perte de confiance ou une autonomie réduite peuvent également s’installer en conséquence.
Une prise en charge rapide limite l’apparition de complications secondaires et aide l’enfant à acquérir la marche, socle de son autonomie et de sa vie sociale.
Des solutions concrètes pour accompagner et encourager la marche en douceur
Accompagner un marcheur tardif commence par respecter la motricité libre. Laisser le jeune enfant explorer à son propre rythme, sans forcer ni accélérer, soutient ses progrès et bâtit sa confiance. Un espace sécurisé, spacieux, débarrassé des obstacles inutiles, multiplie les occasions d’essais : ramper, s’asseoir, se dresser, puis marcher.
Certains jeux et accessoires sont des alliés précieux pour stimuler la motricité globale :
- blocs à empiler, tunnels, balles souples, trottinettes évolutives : tous ces objets sollicitent équilibre, coordination et force musculaire.
La marche pieds nus, fréquemment recommandée par les spécialistes, favorise le développement musculaire du pied, l’ajustement aux irrégularités du sol et la précision des mouvements. Les chaussures légères et flexibles ne sont nécessaires qu’à l’extérieur ou sur sols froids.
À l’inverse, évitez de recourir aux trotteurs et chaises rebondissantes : loin d’être des accélérateurs, ils freinent l’apprentissage des repères corporels et peuvent retarder la marche.
Si un trouble est avéré, la rééducation par un kinésithérapeute devient indispensable. Les exercices proposés, personnalisés, ciblent l’équilibre, le tonus, la coordination. Parfois, une aide à la marche sur mesure complète l’accompagnement. Sans oublier l’importance d’une alimentation adaptée, riche en énergie, pour soutenir l’activité physique quotidienne.
La vigilance des parents reste la meilleure alliée : aménagez l’espace, éliminez les risques de chute, encouragez chaque progrès, mais laissez le tempo à l’enfant. La marche n’est pas une course, c’est une aventure qui mérite d’être accompagnée avec confiance et bienveillance.
Voir son enfant s’élancer pour la première fois, hésitant puis de plus en plus assuré, c’est assister à la naissance de son autonomie. Derrière chaque pas, il y a un monde qui s’ouvre, et rien ne remplace la patience, ni la fierté qui accompagne ces débuts.